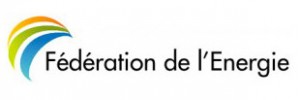Laâyoune-Sakia El Hamra : Une stratégie intégrée pour une gestion durable des ressources hydriques
Face aux défis liés à la rareté de l’eau et aux impacts du changement climatique, la région de Laâyoune-Sakia El Hamra se distingue comme une référence nationale en matière de gestion intégrée et durable des ressources en eau.
Portée par une vision coordonnée entre acteurs institutionnels, territoriaux et techniques, cette stratégie repose sur l’innovation, la planification à long terme et la mobilisation de nouveaux leviers d’approvisionnement, conformément aux Hautes Orientations Royales en matière de durabilité.
Fruit d’une approche concertée, cette dynamique régionale vise à sécuriser l’accès à l’eau potable, moderniser les infrastructures, préserver le capital hydrique et garantir un développement équilibré, au service des populations urbaines comme rurales.
Cette stratégie intégrée se concrétise à travers une politique ambitieuse d’aménagement hydraulique, marquée par la construction de grands barrages, le développement d’ouvrages de proximité et la mobilisation de nouvelles ressources pour renforcer la sécurité hydrique et la résilience du territoire face aux aléas climatiques.
– Un barrage stratégique pour la sécurité hydrique régionale
Symbole d’une politique volontariste, le grand barrage de Sakia El Hamra constitue un projet structurant visant à protéger la ville de Laâyoune contre les inondations et à renforcer la recharge des nappes phréatiques dans les zones situées en aval. Selon M’Hamed Errahimi, chef d’aménagement du barrage, les travaux de reconstruction affichent un taux d’avancement d’environ 89%.
Porté par le ministère de l’Équipement et de l’Eau, cet ouvrage d’une capacité de stockage de 113 millions de m³ sera raccordé à un canal pour la recharge artificielle de la nappe de Foum El Oued.
D’un coût global estimé à 652 millions de dirhams (MDH), il comprend les études d’exécution, les travaux de génie civil du barrage, des ouvrages annexes (évacuateur de crue, vidange de fond et prises d’eau) et les équipements hydro-électromécaniques, ainsi qu’un dispositif d’auscultation permettant le suivi du comportement du barrage pendant la phase d’exploitation.
– Dix-sept petits barrages et plusieurs lacs collinaires pour renforcer la résilience locale
En parallèle, la région compte 17 petits barrages et lacs collinaires, concentrés en grande partie dans la province d’Es-Semara. Ces infrastructures, selon le directeur de l’Agence du bassin hydraulique de Sakia El Hamra et Oued Eddahab, Sidi Mokhtar El Kanti, s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie nationale de l’eau, du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation 2020-2027 (PNAEPI) et du plan directeur d’aménagement intégré du bassin (PDAIRE).
Ces ouvrages de proximité permettent de mobiliser et de stocker les eaux de ruissellement pour soutenir l’agriculture solidaire et pastorale, favoriser l’abreuvement du cheptel, recharger les nappes phréatiques et prévenir les inondations.
Leur impact social est déjà notable puisqu’ils permettent une amélioration de l’accès à l’eau dans les zones enclavées, le maintien des activités rurales et la réduction de l’exode vers les centres urbains.
– L’ONEE, acteur clé de la politique de l’eau
L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) a joué, depuis 1975, un rôle primordial dans la production et la distribution d’eau potable, ainsi que dans l’assainissement liquide des eaux usées dans la région.
Selon son directeur régional, Mohamed Boubekri, le volume total des investissements réalisés s’élève à environ 5,4 milliards de dirhams, dont un montant de l’ordre d’un milliard de dirhams dédié à des projets actuellement en cours de réalisation pour le renforcement et la sécurisation de l’alimentation en eau potable dans la région. Ces projets ont permis d’atteindre un taux de desserte en eau potable de 100 % dans le milieu urbain et de plus de 97 % dans le monde rural.
Pour accompagner le développement urbain et la croissance démographique et compte tenu du stress hydrique que connait la région, l’intervention de l’Office a reposé sur quatre axes principaux, à savoir la sécurisation de la production d’eau potable, le renforcement des ouvrages de stockage et de distribution d’eau potable, et l’amélioration des rendements des réseaux de distribution, en plus de l’extension et de la réhabilitation des réseaux des eaux usées et la réalisation des stations d’épuration.
Concernant le renforcement et sécurisation de la production d’eau potable, la région dispose actuellement de huit stations de dessalement d’eau de mer (deux à Laâyoune, deux à Boujdour et quatre à Tarfaya), totalisant une capacité de 66.010 m³ par jour. À cela s’ajoute la déminéralisation des eaux saumâtres via sept stations avec une capacité de 14.420 m³/jour.
Pour ce qui est du renforcement des ouvrages de stockage et de distribution d’eau potable, l’Office a procédé à la réalisation des réservoirs de stockage pour sécuriser l’alimentation en eau potable et l’extension du réseau de distribution pour améliorer la desserte.
S’agissant de l’amélioration des rendements des réseaux de distribution, il a été procédé à la réhabilitation des réseaux vétustes ainsi qu’à la recherche et la réparation des fuites.
Actuellement, un projet de réhabilitation du réseau vétuste de la ville de Laâyoune, dont les études ont été réalisées par l’ONEE, est en phase de lancement des appels par la société régionale multiservices (SRM) Laâyoune-Sakia El Hamra, qui assurera la maîtrise d’ouvrage, pour un montant de l’ordre de 300 MDH.
Placée au cœur du chantier de la régionalisation avancée, cette politique de gestion des ressources hydriques s’appuie sur la participation active des collectivités territoriales et de la société civile, afin de concevoir des solutions locales adaptées aux défis du stress hydrique et du changement climatique.