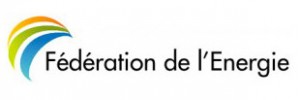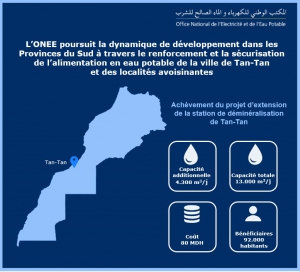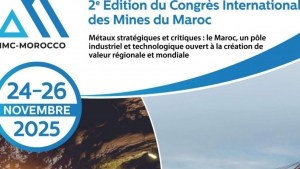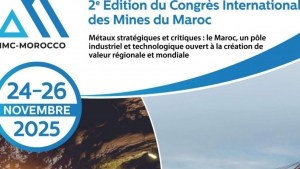
L’Afrique est appelée à élaborer une approche qui protège ses ressources, valorise son potentiel humain et transforme sa richesse géologique en prospérité durable, a souligné le 24 novembre à Marrakech, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.
S’exprimant à l’ouverture du 2e Congrès international des mines (IMC) du Maroc, organisé sous le thème « Métaux stratégiques et critiques : le Maroc, hub industriel et technologique ouvert pour une valeur ajoutée régionale et mondiale », Mme Benali a relevé que « le continent détient des réserves majeures et un atout unique, à savoir la population jeune la plus dynamique au monde ».
« L’Afrique n’est donc pas un acteur secondaire, mais il s’agit d’une puissance géologique, sans laquelle aucune transition énergétique mondiale n’est possible », a-t-elle insisté, relevant que le rythme du changement technologique, la complexité des nouvelles chaînes de valeur et la nature mondiale de la transition énergétique exigent une intelligence collective, des standards alignés et une action coordonnée à l’échelle continentale.
« Alors que le Maroc se positionne comme un hub industriel et technologique, il le fait avec une expérience concrète et des réalisations opérationnelles », a poursuivi la ministre, citant notamment la digitalisation complète du cadastre minier national, l’amendement en cours de la loi relative aux mines et carrières afin de l’aligner sur les transformations régionales et mondiales et la digitalisation de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle, incluant une plateforme numérique inédite, « fa7m.ma », en cours de déploiement à Jerada.
De son côté, le président de la Fédération de l’Industrie minérale du Maroc (FDIM), Mohamed Cherrat, a souligné que sous la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le secteur minier joue un rôle stratégique dans la construction d’un Maroc souverain, compétitif et durable, notant que « nos ressources minérales soutiennent directement et indirectement les grandes filières industrielles et renforcent la production du Maroc au cœur des conditions énergétiques, technologiques et géopolitiques mondiales ».
« Alors que l’Afrique consolide sa position dans les chaînes d’approvisionnement mondiales en matières premières, le Maroc s’impose comme un passage privilégié, voire incontournable, grâce à son expertise croissante, à ses écosystèmes industriels émergents, mais aussi à de nombreux accords de libre-échange permettant un accès public au marchés internationaux ».
Organisé par la FDIM en partenariat avec AME Trade Ltd, avec le soutien du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), cet événement international positionne le Maroc comme une référence en matière d’exploitation minière responsable et de transformation industrielle au 21e siècle, mettant en évidence son rôle de passerelle vers les minerais critiques africains et la transition verte mondiale.
Au programme de cette rencontre, qui a pris fin 26 novembre, figuraient notamment un panel ministériel organisé par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, ainsi que des séances plénières de haut niveau sur les chaînes de valeur durables, les enjeux géopolitiques, la souveraineté minière, les pratiques responsables et le rôle des minerais stratégiques dans la transition énergétique.
Des sessions thématiques consacrées à la géométallurgie, la gestion de l’eau dans les mines, la formation des compétences, les corridors logistiques ou encore la place des femmes dans le secteur ont été également au rendez-vous, suivies d’une présentation de projets phares transformant l’industrie minière au Maroc et en Afrique et des espaces consacrés aux rencontres professionnelles qualifiées et à la mise en relation institutionnelle et industrielle.
Il a été également question de mettre à l’honneur l’avenir du secteur minier et ce, dans le cadre de la première édition des Prix d’Excellence Minière IMC pour distinguer les initiatives les plus remarquables en la matière.
Les catégories incluent notamment « le Meilleur poster scientifique », « le Projet entrepreneurial de l’année », « le Meilleur projet en matière de responsabilité environnementale et sociale », « le Prix du leadership féminin dans les mines », « l’Entreprise minière de l’année », « le Projet minier pionnier de l’année » et « le Prix d’honneur pour l’ensemble d’une carrière ».