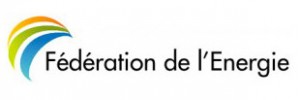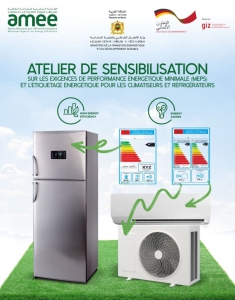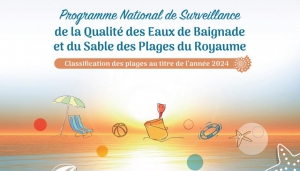La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a eu des entretiens, le 14 mai à Rabat, avec le vice-Premier ministre et ministre de l’Énergie de la République-Unie de Tanzanie, Doto Mashaka Biteko, axés sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la transition énergétique durable. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre le Royaume du Maroc et la République-Unie de Tanzanie, fondés sur la solidarité, le respect mutuel et une vision commune du développement inclusif et durable.
Lors de cette rencontre, Mme Benali a souligné que l’Afrique constitue une priorité stratégique pour le Maroc, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui a fait de la coopération Sud-Sud un pilier central de la politique étrangère du Royaume.
A ce titre, la visite historique du Souverain en Tanzanie en 2016 a marqué une étape majeure dans la consolidation des relations bilatérales, posant les bases d’une coopération multisectorielle ambitieuse, notamment dans les domaines de l’énergie, des mines, du développement des infrastructures, du tourisme et du capital humain.
Les discussions entre les deux ministres ont mis en lumière les nombreuses opportunités de partenariat entre les deux pays, particulièrement dans les domaines des énergies renouvelables, de l’électrification rurale, de l’hydrogène vert et de l’infrastructure électrique, ainsi que dans le cadre d’initiatives communes favorisant le transfert de savoir-faire et le renforcement des capacités.
À cette occasion, Mme Benali et M. Mashaka Biteko ont réaffirmé leur ferme volonté de renforcer la coopération entre le Maroc et la Tanzanie à travers l’exploration de nouvelles perspectives de développement des relations et l’élargissement des domaines de partenariat dans les secteurs d’intérêt commun, dans le but de servir les intérêts des deux pays et de contribuer au développement durable à l’échelle régionale.
Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, Mme Benali a indiqué que les discussions ont porté sur l’importance d'”apporter de l’électricité et de l’énergie propres à nos populations”.
Cette rencontre a été également l’occasion de passer en revue les grands projets lancés par le Royaume dans le domaine de l’énergie ainsi que les efforts de reconstruction après le séisme d’Al Haouz “qui nous ont permis de tester certains modèles financiers et techniques avec des minis-réseaux, des batteries et du solaire, au profit des populations touchées”.
Dans une déclaration similaire, M. Mashaka Biteko a indiqué que cette visite constitue une occasion pour échanger les expériences des deux pays en matière de transition énergétique durable, rappelant à cet égard l’adoption de la Déclaration sur l’énergie de Dar es Salaam, approuvée en janvier 2025 lors du Sommet africain de l’énergie “Mission 300”, qui ambitionne de fournir de l’électricité à 300 millions de personnes qui en sont privées. Le ministre tanzanien effectue une visite de travail au Royaume du 13 au 15 mai, à la tête d’une importante délégation.