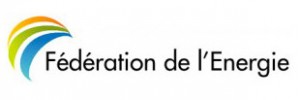Les travaux de la 19e édition du Congrès Mondial de l’Eau, ont été sanctionnés, le 5 décembre, par l’adoption de la « Déclaration de Marrakech », un appel à élever l’eau au rang de priorité mondiale.
La Déclaration insiste ainsi sur la nécessité d’élever l’eau au rang de priorité mondiale au niveau de toutes les plateformes internationales, y compris la COP 31, la Conférence de l’ONU 2026 sur l’eau et le 11ème Forum mondial de l’eau en 2027, étant donné que la sécurité hydrique est menacée dans le monde entier, impactant la santé, l’agriculture, l’énergie, les écosystèmes et les économies, ainsi que la paix, la stabilité et la prospérité partagée.
Le document souligne, dans ce sens, le besoin urgent d’innovation et d’adaptation dans la gestion de l’eau, dans un contexte marqué par des pressions croissantes sur les systèmes d’approvisionnement en eau découlant de plusieurs défis mondiaux tels que les changements climatiques, la croissance démographique, l’urbanisation rapide, la dégradation des sols et la pollution.
Les modèles de gouvernance et de développement des infrastructures doivent évoluer pour faire face à ces défis complexes, note la Déclaration, relevant qu’il est nécessaire de promouvoir l’innovation éthique et responsable dans la gestion de l’eau, afin d’accélérer la réalisation de l’objectif de développement durable (ODD).
La Déclaration préconise également d’investir dans l’adaptation et l’atténuation des changements climatiques en priorisant des infrastructures d’eau résilientes et des solutions à faible teneur en carbone, telles que le dessalement de l’eau de mer à l’aide d’énergies renouvelables, la réutilisation des eaux usées, la récolte des eaux de pluie, outre l’amélioration de la gestion des catastrophes et risques liés à l’eau.
Elle encourage, par ailleurs, le renforcement de la coopération bilatérale, sous-régionale, régionale, internationale et multilatérale dans le domaine de l’eau, en partageant notamment les données, les technologies et les expertises.
En outre, le document met l’accent sur l’importance d’assurer une gouvernance participative de l’eau à travers l’engagement de toutes les parties prenantes, y compris les femmes, les jeunes, la société civile et les communautés locales, dans la conception et la mise en œuvre de solutions pour les problématiques liées à l’eau.
Il s’agit aussi de renforcer la sensibilisation et la recherche scientifique autour de l’eau et de favoriser la mise en place de plateformes de coopération et d’innovation afin de surmonter collectivement les défis liés à l’eau.
La Déclaration appelle, de même, à mobiliser des ressources financières plus importantes, afin de garantir que tous les projets et investissements publics et privés soient résilients et innovants et contribuent activement à la sécurité et la résilience hydrique.
Elle souligne également l’impératif de reconnaître la nature interconnectée de l’eau avec d’autres secteurs, en intégrant les aspects économiques, sociaux et environnementaux dans tous les processus de planification des ressources en eau, ainsi que de soutenir le droit à l’eau par le biais de politiques, de pratiques et d’une coopération internationale renforcée.
Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19è édition du Congrès Mondial de l’Eau, coorganisée par le ministère de l’Équipement et de l’Eau et l’Association Internationale des Ressources en Eau (IWRA) sous le thème « L’eau dans un monde qui change : Innovation et adaptation », a été l’occasion d’explorer des solutions innovantes, des stratégies et des approches adaptatives pour les ressources en eau dans un monde en changement permanent.
Cet événement a ainsi offert une plateforme aux experts, praticiens, chercheurs, décideurs politiques, société civile et secteur privé pour échanger des connaissances, présenter des recherches novatrices, établir des partenariats et développer conjointement des solutions concrètes visant à relever les défis complexes de la gouvernance, de la sécurité et de la durabilité mondiales de l’eau.