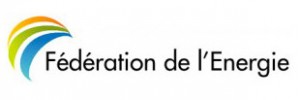Le 10 janvier 2023, s’est tenue au siège de la CGEM, une rencontre présidée par M. Abdou Diop, président de la commission Afrique de la Confédération avec une délégation de représentants de la République de Djibouti avec la participation des représentants de Masen , de la fédération de l’ Energie, du Laboratoire Laprophan et Laboratoire Soludia Maghreb et l’Association Régionale des agences de voyages de Casablanca-Settat.
La délégation djiboutienne était composée de:
– M. Samir Salem Mouti : Conseiller du Président de la République chargé des investissements,
– M. Alexis Mohamed : Chargé de mission du Président de la république,
– M. Abdallah Ibrahim Abdallah : Directeur Général Adjoint de la banque pour le Commerce et L’industrie,
– Dr Saad Farah Barreh : Représentant des pharmaciens,
Lors de cette rencontre, les membres de la délégation djiboutienne ont présenté la situation géoéconomique de leur pays, petit par la taille mais qui nourrit des ambitions importantes pour son développement.
Pour ce faire, ils cherchent des partenaires sur des projets gagnants -gagnants dans leur pays entre –autres des partenariats d’affaires avec des entreprises marocaines dans tous les secteurs.
En ce qui concerne le secteur énergétique, et principalement l’Energie verte, ils ont exprimé un besoin de 300MW en solaire, éolienne et géothermie avec une croissance annuelle de 20 MW.
A noter que Masen est déjà présente à Djibouti par un projet en cours de 30 MW solaire, ce qui peut encourager d’autres entités marocaines à prospecter ce marché.
A noter que Djibouti est la seule porte portuaire de l’Ethiopie qui est un marché de 120 Millions d’habitants et qui peut ainsi faciliter l’accès des entreprises marocaines à ce marché.
La coopération entre le Maroc et plusieurs autres pays africains dans divers secteurs, en particulier celui des énergies renouvelables, constitue un modèle consacrant l’engagement du Royaume à consolider la coopération Sud-Sud.
Washington a abrité récemment une rencontre du Conseil des Affaires USA-Nigeria, qui s’est penchée notamment sur le rôle joué par le Maroc et le Nigeria dans le cadre de la coopération régionale et l’avenir du secteur énergétique en Afrique.
Lors de cette rencontre, les participants ont abordé également les différents aspects du partenariat liant le Royaume au Nigeria, qui représente un modèle dans le secteur des énergies renouvelables, notamment le projet de gazoduc entre les deux pays.
Dans ce cadre, le directeur général du fonds d’investissement Ithmar Capital, Obaid Amrane, a bien voulu répondu aux questions au sujet de la coopération entre le Maroc et plusieurs autres pays du continent.
Créé en 2011, Ithmar est un fonds d’investissement stratégique avec pour vocation première l’accompagnement du développement économique du Maroc. Fonds multisectoriel, Ithmar vise à promouvoir l’investissement dans tous les secteurs stratégiques nationaux en développant des projets structurants et transformationnels avec un fort impact.
1.Comment le Maroc et le Nigeria peuvent-ils contribuer à travers leur partenariat à l’essor économique du continent africain ?
Le Maroc et le Nigeria sont deux pays importants de la région de l’ouest du continent, qui, au-delà des accords signés, ont réalisé des projets concrets, notamment le projet de gazoduc. Ce projet aura un impact significatif sur la transition énergétique, la croissance économique et la sécurité énergétique.
C’est en fait un projet transformationnel, qui sera à l’origine d’un changement du paradigme énergétique, du fait qu’il permettra d’accéder à une énergie décarbonée, de libérer le potentiel des énergies renouvelables et de favoriser l’émergence de nouvelles industries à forte valeur ajoutée.
2.Le Maroc connaît un essor dans le secteur des énergies renouvelables. Comment peut-il mettre à profit son expertise au service du reste du continent ?
Grâce à la clairvoyance du leadership de SM le Roi Mohammed VI dans les domaines des énergies renouvelables et du développement durable, le Maroc a pu acquérir une grande expérience qui est aujourd’hui sollicitée par les pays africains.
Cette expérience a permis au Royaume, grâce aux hautes orientations royales, de se classer parmi les pays leaders en matière d’efficacité énergétique et de développement durable.
3.Quelle est l’importance de l’organisation à Washington d’une rencontre entre le Maroc et le Nigeria avec comme focus l’avenir du secteur énergétique en Afrique ?
Ce genre d’évènements revêt une importance capitale, puisque ça permet d’améliorer la connectivité entre les différents acteurs et de créer des ponts entre les investisseurs et les opérateurs économiques.
Le fonds d’investissement Ithmar Capital était présent à cette rencontre pour mettre en avant les réalisations du Royaume en matière de coopération Sud-Sud, notamment dans les domaines des infrastructures et de l’énergie.
La rencontre a également été l’occasion d’échanger avec les différentes parties prenantes sur les activités et projets menés dans le cadre du Forum africain des investisseurs souverains, qui regroupe 10 fonds souverains au continent avec pour objectif de développer et de lancer des projets d’infrastructures à dimension régionale dans les domaines de l’énergie, de la transition énergétique, de la sécurité alimentaire, du numérique et de la logistique.
L’Afrique est un continent d’avenir, avec un taux de croissance parmi les plus importants au niveau mondial. C’est également une destination prisée par les opérateurs américains, ce qui offre des opportunités d’investissement importantes dans le cadre d’une approche win-win.
La balle est maintenant dans le camp des opérateurs africains pour promouvoir un développement global et durable.
L’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité (ANRE) vient de fixer la méthodologie de détermination du tarif d’utilisation du réseau électrique national de transport.
En effet, le Conseil de l’ANRE a adopté, récemment et à l’unanimité, la méthodologie de détermination du tarif dudit réseau électrique national de transport, indique l’Autorité dans un communiqué, précisant que cette méthodologie fixe les règles et les modalités selon lesquelles le tarif sera calculé et appliqué aux utilisateurs dudit réseau.
L’ANRE conclut ainsi un long processus de concertation de près de huit mois avec les principales parties prenantes concernées par ce sujet, notamment, l’ONEE en sa qualité actuelle de Gestionnaire du Réseau Transport (GRT), le ministère de l’Intérieur, agissant pour le compte des régies et autres entités de distribution ainsi que les membres de la Fédération de l’énergie.
L’ANRE a aussi sondé le point de vue du grand public au moyen d’une consultation publiée sur son site web et dont le délai a été prolongé suite à la demande de certaines parties. Au cours de ce processus, l’ANRE a veillé à prendre en considération, dans toute la mesure du possible, les commentaires et contributions exprimés.
La méthodologie adoptée constitue le premier cadre tarifaire indépendant et transparent, conçu dans le cadre des dispositions de la loi n°48-15 relative à la régulation du secteur de l’électricité et à la création de l’ANRE. Elle comporte un ensemble de principes éprouvés au niveau national et international tout en introduisant de nouveaux éléments favorables à l’équité, à la transparence et au développement du secteur électrique national conformément aux orientations de la stratégie énergétique nationale.
Cette méthodologie consacre aussi les principes de mutualisation des coûts et de péréquation territoriale en préconisant un tarif unique d’utilisation du réseau électrique national de transport sur l’ensemble du territoire national.
En ce qui concerne les investissements dans le réseau de transport de l’électricité, l’accent a été mis sur le bon fonctionnement et la sécurité du système électrique en adoptant une procédure d’activation et de contrôle des investissements favorisant l’efficacité et l’amélioration de la qualité.
Et de noter que dans une phase ultérieure, au cours du premier trimestre 2023, l’ANRE fixera le tarif d’utilisation du réseau électrique national de transport sur la base de cette méthodologie pour la période 2023-2025.
A cet égard, et en attendant l’aboutissement du projet en cours de séparation comptable, l’ANRE s’appuiera sur les données comptables de l’activité de transport de l’ONEE.
L’ANRE est une autorité administrative indépendante instituée en vertu de la loi n°48-15. Elle assure le bon fonctionnement du marché électrique national notamment en veillant à la transparence ainsi qu’à l’équité des modalités d’accès et d’utilisation des réseaux électriques nationaux. Elle est ainsi chargée de fixer le tarif d’utilisation des réseaux électriques de transport et de distribution en favorisant l’efficience du système électrique national et la transition énergétique de notre pays.
John Cockerill leader mondial des électrolyseurs alcalins et une entreprise marocaine leader dans le secteur de l’énergie ont conclu un accord visant la création d’une coentreprise offrant des solutions pour la filière hydrogène vert intégrée au Maroc.
Elle comprendra en particulier une usine de fabrication d’électrolyseurs alcalins qui sera la première de son genre en Afrique.
Cette collaboration permet à John Cockerill de contribuer aux objectifs marocains et globaux en matière d’hydrogène vert et d’énergies renouvelables.
L’accord conclu vise en particulier la création d’une gigafactory dédiée à la fabrication d’électrolyseurs destinés à la constitution d’une filière hydrogène vert intégrée au Maroc. Au départ de cette usine, John Cockerill et son partenaire développeront conjointement une chaîne de valeur dédiée à l’hydrogène vert au Maroc, permettant dans le même temps le développement d’une expertise locale et d’emplois dans ce domaine.
La coentreprise aura des capacités de fabrication à grande échelle d’électrolyseurs alcalins de grande puissance (5MW+/Stack Electrolyseur) qui permettront en outre la production d’hydrogène vert au meilleur prix. Ces développements dans l’industrie de l’hydrogène aideront les grandes industries locales à la mise en œuvre d’un écosystème énergétique national axé sur les énergies renouvelables (photovoltaïque et éolien).
La mise en place de l’usine se base sur la grande expérience de John Cockerill au travers de ses autres usines dans le monde et sa capacité à offrir des solutions de production d’hydrogène à grande échelle à ses clients.
Raphaël TILOT, Président exécutif John Cockerill Hydrogen : « Nous sommes honorés de pouvoir contribuer à la transition énergétique du Maroc. A l’image des grandes réussites du Royaume notamment dans l’aéronautique et l’automobile, nous sommes déterminés à établir ensemble un tel écosystème local autour des technologies de l’hydrogène. »
La Chambre des Représentants a tenu, le 3 janvier, une session plénière consacrée à l’examen du rapport annuel de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE), qui avait fait l’objet de débats et d’étude devant la commission compétente à la Chambre des Représentants.
Lors de cette session, présidée par le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, les parlementaires ont mis en avant le travail effectué par l’Autorité, au terme d’une année d’exercice, en ce qui concerne la mise en œuvre des missions qui lui ont été fixées par la loi ou ses relations internationales qui lui ont permis d’accéder à la présidence de l’Association des régulateurs méditerranéens de l’énergie (MEDREG) et à la vice-présidence du Réseau francophone des régulateurs de l’énergie, outre la définition de la future feuille de route développée de l’ANRE qui tend à assurer la sécurité énergétique du pays, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Au cours de leurs interventions, les groupes parlementaires ont mis l’accent sur la restructuration de tous les champs d’intervention, la consolidation d’un marché ouvert à des prix raisonnables et la réalisation de l’autosuffisance surtout avec l’importance cruciale de l’énergie comme l’ont démontré les changements climatiques, la crise du Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne.
Les groupes et le groupement parlementaires ont émis le souhait que cette expérience singulière soit un levier en matière de production d’énergie propre, incite les citoyens à accéder au marché de la production et de la vente et favorise cette opération citoyenne qui aura des incidences positives sur les autres secteurs.
Par ailleurs, la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement à la Chambre des Représentants a appelé à renforcer les rôles de l’ANRE et à les adapter aux exigences et aux évolutions imposées par le développement du secteur de l’électricité.
Dans un document concluant le débat autour du « Premier rapport annuel sur les activités de l’ANRE au titre de l’année 2021″, la Commission a souligné la nécessité d’élargir les prérogatives de l’ANRE pour inclure les secteurs du gaz et des hydrocarbures, tout en la dotant des outils et des ressources matérielles et humaines lui permettant de remplir pleinement les tâches qui lui sont confiées.
La Commission a préconisé dans ce rapport, présenté lors d’une session plénière en présence de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, le règlement des diverses problématiques dont pâtit le secteur de l’électricité, particulièrement les producteurs privés porteurs de projets, l’élargissement des champs énergétiques et la concrétisation des recommandations du Nouveau Modèle de Développement, et la séparation des tâches entre les différents intervenants dans le secteur de l’électricité.
En outre, la Commission a émis une série d’observations et de questionnements relatifs au rapport annuel de l’ANRE, notamment le bilan de ses missions prévues par la loi 48.15, y compris la fixation du tarif d’accès au réseau électrique national de transport et aux réseaux nationaux électriques de la distribution de moyenne tension, en plus du bilan relatif à la neutralité carbone dans les activités énergétiques en général surtout que les centrales électriques à charbon prévalent toujours à un taux de 67,8% de l’ensemble de la production.
Par ailleurs, elle a appelé à une séparation comptable entre les activités de production à l’instar des activités de transport d’énergie électrique, afin d’établir une tarification détaillée précisant les coûts de production, de transport et de distribution afin d’en identifier les failles, tout en préconisant de trouver les raisons derrière le coût élevé de la facture énergétique pour les citoyens et de proposer des solutions appropriées. Dans le même contexte, la Commission a souligné que l’ANRE contribue indirectement à la protection du consommateur, en ouvrant le secteur aux investissements privés et en assurant la transparence dans l’accès à l’information, permettant ainsi l’amélioration de la performance des institutions et de l’économie nationale.
Au terme de cette session, M. Talbi Alami a salué le travail de la Commission, ce qui représente, selon des parlementaires, une source de motivation pour l’ANRE afin de poursuivre ses efforts pour la consolidation de l’édifice énergétique marocain.
La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali a appelé, le 3 janvier, à redoubler d’efforts pour activer les rôles assignés à l’Autorité nationale de régulation de l’électricité (ANRE) et pour la mise en œuvre effective du chantier de régulation de ce secteur.
Intervenant lors d’une séance plénière à la Chambre des représentants consacrée au rapport annuel des activités de l’ANRE au titre de l’année 2021, la ministre a mis l’accent sur l’importance de faire ressortir le chapitre comptable des activités de production, de transport et de distribution de l’électricité, rappelant qu’il contribue à assurer la transparence et l’égalité ainsi qu’à assurer un traitement équitable entre les différents acteurs privés et à les inciter à investir davantage dans les secteurs de l’électricité et de l’énergie.
Mme Benali a également appelé à accélérer la fixation de la tarification pour l’utilisation des réseaux électriques, notamment la tarification d’utilisation des réseaux de distribution d’électricité moyenne tension, mais également à publier les décisions et les tarifications de l’ANRE sur son site web accessible au grand public en vue de consacrer le principe de transparence et de gagner la confiance de tous les acteurs du secteur.
Elle a, dans ce sens, salué la coopération entre le ministère et l’ANRE en vue d’activer les dispositions de la loi 48.15 et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à la régulation de l’électricité afin d’améliorer la qualité de ce service.
Par ailleurs, Mme Benali a indiqué que son département œuvre au parachèvement des décrets d’application nécessaires pour faciliter l’action de l’ANRE après la concertation avec les partenaires concernés, dont les collectivités locales et les secteurs privés et publics, relevant qu’un ensemble de réformes législatives et organisationnelles importantes, dont le projet de loi 40.19 relatif aux énergies renouvelables et la loi 48.15 relative à la réglementation du secteur de l’électricité et la création de l’Autorité nationale de contrôle de l’électricité.
Une action est menée pour élargir le champ de compétences de l’ANRE pour englober la détermination des modalités et conditions commerciales liées à l’achat de l’énergie électrique excédentaire produite à partir de plusieurs sources conformément aux dispositions de la loi 48.15, ainsi que les coûts associés aux services du système tel que défini dans la loi 13.09 portant sur l’énergie électrique renouvelable.
Lors de cette séance, les parlementaires ont souligné l’importance d’accélérer la transition vers le recours aux énergies renouvelables afin d’atteindre l’efficacité et la sécurité énergétique et réduire le coût de l’électricité au bénéfice des citoyens et du tissu économique.
Ils ont notamment insisté sur la nécessité de trouver des solutions à la dépendance énergétique et d’investir dans les sources d’énergie dans la perspective d’un modèle énergétique purement marocain conforme aux recommandations du Nouveau modèle de développement, qui considère la gouvernance énergétique comme un puissant levier de développement.
Ils ont également salué la croissance régulière des indicateurs énergétiques de sources renouvelables, en particulier solaires et éoliennes, qui ont atteint en 2021 une moyenne de 20% des besoins énergétiques nationaux, appelant à continuer sur cette voie afin de réduire la dépendance énergétique à l’étranger, de réduire la facture énergétique et de diminuer l’impact écologique lié à l’utilisation des sources d’énergie fossiles.
La ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, Leila Benali, a effectué, le 5 janvier, une visite de terrain aux principales infrastructures énergétiques dont dispose la ville de Mohammedia.
À la suite de l’incident survenu le 22 décembre 2022, qui n’a fait aucune victime, et seulement quelques dégâts matériels, Leila Benali a voulu intervenir sur le terrain pour évaluer la situation des installations énergétiques, le volume des stocks de produits pétroliers ainsi que les conditions de sécurité et d’environnement.
La ville de Mohammedia comporte de nombreuses infrastructures énergétiques comme des dépôts de stockages d’hydrocarbure et de GPL, tandis que le port de Mohammedia concentre une partie importante des activités de transport et de stockage des produits pétroliers liquides et gazeux.
A cette occasion, Mme Benali, accompagnée d’une importante délégation de son ministère et en présence des autorités locales, a visité le port de Mohammedia, la Société d’Entreposage Communautaire (CEC), les centres d’emplissage des gaz de pétrole liquéfiés et la Société Marocaine de Stockage (SOMAS) et s’est entretenue avec les principaux responsables sur les plans de prévention et les mesures mises en place pour réduire les risques d’incidents.
Au cours de ces entretiens, la ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable a insisté sur la formation des personnels, la promotion des technologies permettant de renforcer la sécurité et l’information des citoyens habitant à proximité.
Au terme de sa visite, Mme Benali a déclaré que la ville de « Mohammedia, constitue la première étape d’une série de visites qui seront programmées à d’autres sites d’installations énergétiques« , faisant savoir que « la prévention et le respect des règles de sécurité pour assurer la protection du personnel, des riverains et de l’ensemble des citoyens sont des éléments fondamentaux pour une meilleure gestion des risques liés à ces installations ».
Le Maroc, grâce à sa politique volontariste, a réalisé des projets importants en énergies renouvelables solaire et éolienne qui lui ont permis un positionnement de leader mondial dans ce secteur, souligne un policy brief du Policy Center for the New South (PCNS).
Intitulé « Le marché de l’hydrogène vert : l’équation industrielle de la transition énergétique« , ce policy brief, rédigé par Mme Mounia Boucetta, précise que selon le dernier rapport Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI), le Maroc est arrivé en tête de l’indice ajusté grâce à ses plans ambitieux pour le solaire, l’éolien et plus récemment l’hydrogène vert, dans la poursuite d’une part d’énergie verte de 52% d’ici 2030.
Dans ce sens, la publication fait savoir que le Maroc a également pris le devant grâce aux Orientations éclairées de Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors de la réunion de travail consacrée, le 22 novembre 2022, au développement des énergies renouvelables et aux nouvelles perspectives dans ce domaine.
A cette occasion, le Souverain a donné Ses Hautes Instructions à l’effet d’élaborer, dans les meilleurs délais, une « Offre Maroc » opérationnelle et incitative, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière de l’hydrogène vert au Royaume.
Le 3 décembre 2022, M. Mostafa Terrab, Président Directeur Général du Groupe Office Chérifien des Phosphates (OCP), a présenté devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un projet d’investissement vert très ambitieux de près de 13 milliards de dollars sur la période (2023-2027) devant permettre à terme d’alimenter l’ensemble de son outil industriel en énergie verte. A cet effet, le Groupe OCP prévoit des investissements importants dans le dessalement des eaux de mer (560 Millions de m3) ainsi que la production de 1 million de tonnes d’ammoniac vert. Ces investissements permettront à l’OCP d’atteindre la neutralité carbone en 2040.
Les Hautes Instructions Royales réaffirment l’intérêt du positionnement du Maroc en capitalisant sur les acquis réalisés, en construisant une offre attractive et opérationnelle et en favorisant le développement de chaînes de valeurs compétitives.
La consolidation des investissements réalisés, ou en cours, particulièrement dans les secteurs des énergies renouvelables, logistiques et industriels, le positionnement géostratégique du Maroc, son climat des affaires qui est l’un des plus attractifs dans la région ainsi que les projets engagés en recherche et développement, notamment à travers l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), sont des facteurs pertinents pour construire l’offre Maroc.
Par ailleurs, la publication souligne que certes, le Maroc dispose d’avantages compétitifs pour approvisionner l’Europe en hydrogène vert et dérivés, toutefois le développement de cette filière remet sur la table les questions stratégiques du développement du marché local par rapport au marché à l’export, la viabilité industrielle à travers l’intégration locale, le développement des infrastructures et l’optimisation des coûts logistiques, le cadre institutionnel et règlementaire approprié ainsi que la place réservée à la recherche et développement (R&D) pour accompagner les développements technologiques.
A cet égard, elle estime que ma compétitivité est à rechercher à tous les niveaux, industriel, logistique et technologique, notant que le triptyque industrie-logistique-RD est plus que jamais le socle consolidé d’émergence de nouvelles filières pour assurer leur viabilité et leur résilience. L’implication de tous les acteurs nationaux dans une vision intégrée, dynamique et modulaire associant, entre autres, les donneurs d’ordre potentiels, les investisseurs, les petites et moyennes entreprises (PME/PMI), les clusters, les développeurs de zones de production et logistique, les start-up, les centres de recherche et de formation est essentielle pour maximiser les impacts locaux sur les plans économique, social et environnemental.
La Commission des secteurs productifs à la Chambre des conseillers a adopté, le 10 janvier à l’unanimité, deux projets de lois relatifs à l’autoproduction de l’énergie électrique et aux énergies renouvelables, en présence de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.
Il s’agit du projet de loi n°82.21 relatif à l’autoproduction de l’énergie électrique et du projet de loi n°40-19 complétant et modifiant la loi n°13-09 relative aux énergies renouvelables et la loi n°48-15 relative à la régulation du secteur de l’électricité et à la création de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité.
Ces projets de lois, qui s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la stratégie énergétique nationale et des recommandations du Nouveau modèle de développement, visent la contribution à la diversification des sources d’approvisionnement de l’énergie à travers l’augmentation de la part des énergies renouvelables, la généralisation de l’accès à l’énergie à des prix compétitifs, la maîtrise de l’énergie ainsi que la protection de l’environnement et la réponse à la demande croissante d’électricité.
Ils contiennent des dispositions garantissant la sûreté et la sécurité du réseau électrique national et l’équilibre entre toutes ses composantes, tant en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables que la promotion de l’autoproduction et ce, en respectant les principes de transparence et de non-discrimination entre tous les intervenants et en tenant compte de la concordance des dispositions des deux projets de loi chacun dans son champ d’application.
Selon le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, ces projets de lois offrent également la possibilité de stockage et d’entreposage de l’énergie, aussi bien pour l’utilisateur de l’installation d’énergie renouvelable que pour l’auto-producteur, et prévoient la simplification et la digitalisation des procédures et la réduction des délais d’étude et de traitement des dossiers soumis pour autorisation à l’administration.
Dans ce sens, Mme Benali a souligné l’importance de ces lois dans le processus de transition énergétique du Royaume, conformément aux Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI, ajoutant que leur entrée en vigueur aura un impact positif sur tous les acteurs publics et privés concernés.
Ces lois permettront également de renforcer l’attractivité du secteur des énergies renouvelables pour l’investissement, de donner la visibilité nécessaire aux investisseurs et de renforcer les capacités nationales et le transfert de technologie. Elles contribueront aussi à la création d’emploi et au développement local, faciliteront la gestion de l’équilibre entre l’offre et la demande et renforceront le tissu entrepreneurial et la transformation du consommateur en un producteur efficace de l’énergie.
En effet, le projet de loi n°82.21, relatif à l’autoproduction d’énergie électrique, vise à mettre en place un mécanisme robuste de régulation de l’activité d’autoproduction d’énergie électrique, indépendamment de la nature du réseau, le niveau de tension, et la capacité de l’installation utilisée, avec la possibilité d’accéder au certificat d’origine, qui est considéré comme une preuve de l’utilisation par l’auto-producteur d’électricité provenant de sources renouvelables.
Le projet de loi n°40-19 complétant et modifiant la loi n°13-09 relative aux énergies renouvelables et la loi n°48-15 relative à la régulation du secteur de l’électricité et à la création de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité, prévoit, quant à lui, le développement de projets d’énergies renouvelables par le privé, l’adoption de solutions visant à renforcer le rendement des projets d’énergies renouvelables et la résilience du système électrique.
Les participants à une rencontre, organisée le 16 décembre à Washington sur le rôle du Nigeria et du Maroc dans le cadre de la coopération régionale et l’avenir du secteur énergétique en Afrique, ont souligné que les deux pays peuvent bénéficier de la transformation que connaissent les besoins du marché mondial de l’énergie, notant que ce partenariat bilatéral solide joue un rôle important dans la sécurisation de l’avenir énergétique mondial.
Au cours de cette rencontre, initiée par le Conseil du Commerce USA-Nigéria en partenariat avec l’ambassade du Maroc à Washington, les participants ont estimé que ce partenariat ne se limite pas à favoriser la prospérité du continent africain, mais contribue également à développer l’avenir de l’énergie aux niveaux régional et international.
Ils ont souligné, lors de cette rencontre tenue en marge du Sommet des dirigeants États Unis-Afrique, que les défis posés au niveau mondial, notamment les répercussions de la pandémie du Covid-19, la crise énergétique et alimentaire, ainsi que le changement climatique, font du partenariat entre le Maroc et le Nigeria un modèle pour développer l’avenir des énergies renouvelables dans le monde.
A cet égard, le ministre nigérian de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement, Otunba Adeniyi Adebayo, a mis en avant les efforts déployés par le Maroc et le Nigeria visant à assurer l’accès à l’énergie et lutter contre le changement climatique. Cela passe notamment, a-t-il dit, par la hausse des investissements dans le secteur des énergies renouvelables, notamment l’énergie solaire.
Le ministre a estimé que les défis actuels, notamment les répercussions de la pandémie du Covid-19 et les différentes crises que connaît le monde aujourd’hui, démontrent l’importance de la coopération afin d’atténuer l’impact de la crise énergétique et sécuriser l’avenir du secteur dans le monde.
Pour sa part, la directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), Amina Benkhadra, a indiqué que la coopération entre le Maroc et le Nigeria vise à établir un modèle de coopération Sud-Sud et à agir en tant que catalyseur des opportunités économiques africaines.
Elle a souligné que SM le Roi Mohammed VI œuvre, depuis plus de deux décennies, à imprimer une forte impulsion à la coopération Sud-Sud et au partenariat mutuellement bénéfique entre les deux parties, expliquant que le projet de gazoduc entre le Maroc et le Nigeria représente un cadre idoine pour l’action commune.
La responsable a noté qu’il existe une demande continue pour les investissements dans les infrastructures de la part des économies ouest-africaines, ce qui offre un potentiel de croissance important.
Elle a ajouté que le projet de gazoduc va acheminer plus de 8 milliards de mètres cubes de gaz naturel à travers la région, ce qui stimulera la production d’électricité et contribuera à améliorer l’accès à l’énergie dans les pays traversés.
Mme Benkhadra a également passé en revue les avantages économiques que le projet apportera à la région, en exploitant les énergies renouvelables de manière à respecter l’engagement du continent en matière de protection de l’environnement.
Grâce à son essor en matière de développement durable, son important potentiel dans le secteur des énergies renouvelables, sa proximité des marchés européens et américains, sa dynamique d’innovation et sa politique climatique ambitieuse menée par SM le Roi Mohammed VI, le Maroc est idéalement positionné pour saisir les opportunités qui s’offrent dans ce domaine, en construisant un partenariat gagnant-gagnant.
Le Royaume, qui a développé des partenariats solides avec les pays africains dans de nombreux secteurs, peut offrir son expertise aux pays africains, a indiqué Mme Benkhadra.
De son côté, le directeur général et PDG de la Nigeria Sovereign Investment Authority (NSIA), Aminu Umar-Sadiq, a passé en revue le développement du processus du partenariat entre le Maroc et le Nigeria, qui a débuté par l’importation par son pays d’engrais du Maroc avant de se développer à travers l’immense projet de gazoduc.
A cet égard, il a exprimé sa gratitude à SM le Roi et salué le rôle des institutions marocaines qui ont contribué au développement de l’importation de phosphates par le Nigeria.
Après avoir souligné les efforts de la NSIA dans le domaine du développement des énergies renouvelables, M. Umar-Sadiq a exprimé sa fierté de travailler avec des partenaires marocains dans le domaine de la transition énergétique.
Quant à Benedict Oramah, président de la Banque Africaine d’Import-Export, il a souligné l’importance d’investir dans les énergies renouvelables, dans le but de faire face aux défis posés par le changement climatique aux niveaux régional et international.
Le Maroc et le Nigeria occupent deux emplacements stratégiques sur le continent, a-t-il noté, ajoutant que le Nigéria dispose d’abondantes ressources en gaz et que le Maroc, à son tour, possède d’énormes ressources en phosphate ainsi que la capacité de produire des engrais propres.
Il a souligné que le partenariat entre le Maroc et le Nigeria va non seulement soutenir la production d’engrais au profit du continent, mais aussi assurer l’approvisionnement de l’énergie à l’Europe à travers le projet de gazoduc.
Cinq mémorandums d’entente tripartites ont été signés au début du mois à Rabat, dans le cadre du projet de gazoduc Nigeria-Maroc.
Ces accords ont été signés respectivement et successivement entre le Maroc et le Nigeria, d’une part, et par la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée, la Sierra Leone et le Ghana, d’autre part.
Ces mémorandums d’entente, à l’instar de ceux signés avec la CEDEAO le 15 septembre 2022 et ceux signés avec la Mauritanie et le Sénégal le 15 octobre 2022, confirment l’engagement des parties dans le cadre de ce projet stratégique qui, une fois achevé, fournira du gaz à l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest et permettra également une nouvelle voie d’exportation vers l’Europe.
Le gazoduc Nigeria-Maroc va contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations, l’intégration des économies de la sous-région et l’atténuation de la désertification grâce à un approvisionnement en gaz durable et fiable respectant les engagements du continent en matière de protection de l’environnement. Le projet permettra également de donner à l’Afrique une nouvelle dimension économique, politique et stratégique.
Ce gazoduc longera la côte ouest-africaine depuis le Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu’au Maroc.
Il sera connecté au Gazoduc Maghreb-Europe et au réseau gazier européen. Cette infrastructure permettra aussi d’alimenter les États enclavés du Niger, du Burkina Faso et du Mali.
Sitemap
Coordonnées
23, BD Mohamed Abdou
20340 Casablanca
Tél: 06.62.83.09.34
Email: federationenergie@gmail .com