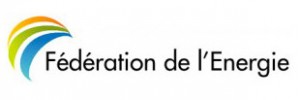Le solaire photovoltaïque constitue une solution concrète pour améliorer la compétitivité des exportateurs à travers la réduction des coûts de production et des émissions carbones, ont souligné les participants à une rencontre débat organisée, récemment, par l’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX).
Lors de cette rencontre, initiée en partenariat avec la Banque Populaire et Adiwatt sous le thème « le solaire photovoltaïque au service de la décarbonation des industries exportatrices », les experts et spécialistes ont fait également part de leurs expériences et donné des indications sur l’élaboration du bilan carbone et le plan de décarbonation.
Ainsi, le vice-président de l’ASMEX, Hakim Marrakchi, a mis en avant l’importance d’une démarche axée sur le solaire photovoltaïque comme solution en faveur de l’amélioration de la compétitivité des exportateurs, soulignant les avantages de l’énergie verte comme solution face aux exigences du marché international. « Aujourd’hui, il ne suffit plus de baisser sa consommation d’énergie, mais de trouver des solutions viables sur le long et moyen termes car le prix de l’énergie flambe (…) ».
L’orientation stratégique du Royaume vers une économie verte pousse tous les industriels à adopter les bons réflexes et à aller vers des solutions écologiques, durables et optimales. C’est essentiel pour positionner l’offre exportable nationale sur le marché international en général et européen en particulier.
Par ailleurs, les experts ont révélé quelques éléments clé pour la réussite du projet solaire photovoltaïque ou encore les solutions de financement mises à la disposition des industriels en terme de mix électrique.
A ce titre, le Directeur Exécutif marché PME de la Banque Populaire, Mohamed Amimi, a fait part des formules d’accompagnement financier mises en place et dont bénéficient déjà plusieurs centaines d’entreprises, notant que la Banque Populaire accompagne toutes les entreprises, pour franchir ce cap dans le cadre de sa stratégie RSE.
Un engagement qu’on peut définir par le financement des grands projets relatifs aux énergies renouvelables, l’émission de Green Bonds destinés à refinancer des projets d’énergie renouvelable marocains, l’évaluation de l’impact environnemental de chaque crédit d’investissement en amont de l’examen par le Comité de Crédit, pour enfin, mettre en place un dispositif complet visant à accompagner les entreprises dans leur démarche d’efficacité énergétique à travers des offres de financement adaptées.
Pour détailler les étapes importantes de la transition vers l’énergie verte, Mme Fatima Zahra El Khalifa, directeur général du Cluster Solaire, M. Mohamed Adnane Berbache représentant Ucotra Consulting, Mme Meriem Berrada Elmandjra VP business development à ADIWATT Afrique et M. Habib Benaddi, le directeur technique de la même entreprise, ont présenté des solutions réalisables à des coûts différents et adaptables aux budgets et à la taille de différentes entreprises, fait savoir l’ASMEX.
A cet égard, Mme Berrada a affirmé que l’empreinte carbone du photovoltaïque est 8 fois moins importante que celle de l’électricité réseau, ajoutant qu’un système photovoltaïque émet en moyenne 55 g d’équivalent CO2 par kWh produit, alors que la moyenne du mix électrique marocain (estimé) est de 72 g, et celle du mix mondial de 430 g.
Aussi, l’accent a été mis en particulier sur le retour sur investissement estimé au bout de 4 ou 5 ans, pour une durée de vie des panneaux solaires photovoltaïques, pouvant aller jusqu’à 25 ans.
La faisabilité du projet passe par six étapes essentielles, la faisabilité sur mesure, les financements, la fourniture et installation, la mise en service, la maintenance, et la supervision.
Au-delà de la protection de l’environnement, décarboner garantit aujourd’hui aux entreprises exportatrices la profitabilité de leur industrie et sa pérennité puisqu’elles s’engagent dans la dynamique internationale en faveur du climat.